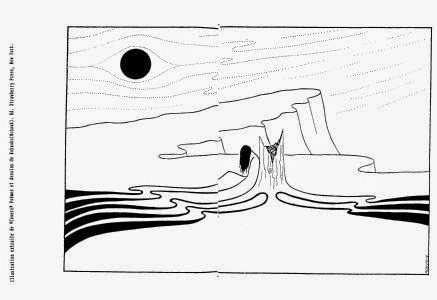Plus les positions de l'industrie culturelle se renforcent, plus elle peut agir brutalement envers les besoins des consommateurs, les susciter, les orienter, les discipliner, et aller jusqu'à abolir l'amusement : aucune limite n'est plus imposée à un progrès culturel de ce genre. Mais la tendance est immanente au principe même de l'amusement "éclairé" et bourgeois. Si le besoin d'amusement a été produit dans une large mesure par l'industrie qui utilisait le sujet d'une œuvre pour la recommander aux masses, la reproduction d'une friandise pour vanter la chromolithographie et, inversement, l'image du pudding pour faire vendre la poudre de pudding, l'amusement lui, a toujours révélé combien il dépendait de la manipulation commerciale, du baratin du vendeur, du bonimenteur des foires. Mais l'affinité qui existait à l'origine entre les affaires et l'amusement apparaît dans les objectifs qui lui sont assignés : faire l'apologie de la société. S'amuser signifie être d'accord. Ce n'est possible que si on isole l'amusement de l'ensemble du processus social, si on l'abêtit en sacrifiant au départ la prétention qu'a toute œuvre, même la plus insignifiante, de refléter le tout dans ses modestes limites. S'amuser signifie toujours : ne penser à rien, oublier la souffrance même là où elle est montrée. C'est effectivement une fuite mais, pas comme on le prétend, une fuite devant la triste réalité ; c'est au contraire une fuite devant la dernière volonté de résistance que cette réalité peut encore avoir laissé subsister en chacun. La libération promise par l'amusement est la libération du penser en tant que négation. L'impudence de cette question qui est de pure rhétorique : "que croyez-vous que les gens réclament ?" réside dans le fait qu'elle en appelle à ces gens même en tant que sujets pensants qu'elle a pour tâche spécifique de priver progressivement de leur subjectivité. Même lorsqu'il arrive que le public se révolte contre l'industrie culturelle, il n'est capable que d'une très faible rébellion, puisqu'il est le jouet passif de cette industrie. Il est devenu néanmoins de plus en plus difficile de tenir les gens par la bride. Le progrès de leur abêtissement doit aller de pair avec le progrès de leur intelligence. A l'époque des statistiques, les masses sont trop déniaisées pour s'identifier avec le millionnaire sur l'écran et trop abruties pour s'écarter tant soit peu de la loi du grand nombre. L'idéologie se dissimule dans le calcul des probabilités. Tout le monde ne peut pas avoir de la chance, elle est réservée à celui qui tire le bon numéro, ou plus exactement à celui qui sera désigné par un pouvoir supérieur - le plus souvent par l'industrie même du divertissement que l'on représente toujours à la recherche de cet individu. Les personnes découvertes par les chasseurs de talents et lancées ensuite par les studios cinématographiques représentent le type idéal de la nouvelle classe moyenne dans toute sa dépendance. La starlette doit symboliser l'employée, mais de telle sorte que - à la différence de la jeune fille de la réalité - le splendide manteau du soir semble déjà fait à ses mesures. Si bien que la spectatrice n'imagine pas seulement l'éventualité de se voir elle-même sur l'écran, mais saisit encore plus nettement le gouffre qui l'en sépare. Une seule jeune fille peut tirer le gros lot, un seul homme peut devenir célèbre et même si mathématiquement tous ont la même chance, elle est cependant si infime pour chaque individu, qu'il fait mieux d'y renoncer tout de suite et de se réjouir du bonheur de cet autre qu'il pourrait bien être lui-même et qu'il n'est cependant jamais. Même là où l'industrie culturelle invite encore à la naïve identification, elle la démentit aussi promptement. Nul ne peut plus échapper à soi-même. Jadis, le spectateur voyait son propre mariage dans le mariage représenté à l'écran. Aujourd'hui les gens heureux sur l'écran sont des exemplaires de la même espèce que ceux qui composent le public, mais une telle égalité ne fait que confirmer le gouffre infranchissable qui sépare les éléments humains. La ressemblance parfaite signifie l'absolue différence. L'identité de l'espèce interdit l'identité des cas individuels. Paradoxalement, l'homme comme membre d'une espèce est devenu une réalité grâce à l'industrie culturelle. Chacun n'est plus que ce par quoi il peut se substituer à un autre : il est interchangeable, un exemplaire. En tant qu'individu, il est lui-même remplaçable, pur néant, et c'est justement ce qu'il commence à ressentir lorsque le temps lui fait perdre sa ressemblance. C'est ainsi que se modifie la structure interne de la religion du succès à laquelle, par ailleurs, on tient si fermement. La voie per aspera ad astra, qui implique des difficultés et des efforts, est progressivement remplacée par l'idée d'une loterie à laquelle il suffit de gagner. La part de hasard aveugle qui intervient dans la routine désignant la chanson destinée à être un "tube" ou la figurante dont on pourra faire une héroïne, cette part de hasard aveugle sera exploitée par l'idéologie. Les films soulignent ce hasard. On commence d'abord par faciliter la vie aux spectateurs en exigeant de tous les personnages - sauf le mauvais garçon - qu'ils se ressemblent essentiellement au point d'exclure les physionomies qui ne s'y prêtent pas (des visages comme celui de Garbo par exemple qui n'invitent pas à la familiarité). On leur assure qu'ils n'ont pas besoin d'être différents de ce qu'ils sont et qu'ils réussiraient tout aussi bien sans qu'on attende d'eux qu'ils fassent ce dont ils sont incapables. Mais en même temps on leur fait comprendre que l'effort ne sert d'ailleurs à rien du fait que même la fortune bourgeoise n'a plus aucun rapport avec l'effet mesurable de leur propre travail. Et ils comprennent parfaitement. En réalité, tous reconnaissent dans le hasard grâce auquel un individu a fait fortune, l'autre face de la planification. C'est justement parce que les forces de la société sont à ce point développées en direction de la rationalité, que chacun pourrait devenir ingénieur ou manager, qu'il n'est plus du tout rationnel de se demander en qui la société a investi ses moyens de formation ou sa confiance pour assurer de telles fonctions. Le hasard et la planification deviennent identiques du fait que, devant l'égalité des hommes, le bonheur ou le malheur de l'individu - de la base au sommet de la société - perd toute signification économique. Le hasard lui-même est planifié, non parce qu'il touche tel homme ou tel autre, mais justement parce que l'on croit en lui. Il sert d'alibi aux planificateurs et fait croire que le réseau de transactions et de mesures qu'est devenu la vie laisse de la place aux relations spontanées et directes entre les hommes. Une telle liberté est symbolisée dans les différents secteurs de l'industrie culturelle par la sélection arbitraire de cas banals. Les rapports détaillés que donnent les magazines sur les croisières modestes mais splendides organisées pour les heureux gagnants d'un concours - de préférence une dactylo qui aura sans doute gagné grâce à ses relations avec des sommités locales - reflètent l'impuissance de tous. Ils ne sont que du matériel, à tel point que ceux qui les organisent peuvent faire entrer quelqu'un dans leur paradis et le rejeter aussi vite : il pourra ensuite moisir tout à son aise, ses droits et son travail n'y changeront rien. L'industrie ne s'intéresse à l'homme qu'en tant que client et employé et a en fait réduit l'humanité toute entière - comme chacun de ses éléments - à cette formule exhaustive. Suivant l'aspect qui peut être déterminant à un moment donné, l'idéologie souligne le plan ou le hasard, la technique ou la vie, la civilisation ou la nature. Aux hommes qui sont des employés, on rappelle l'organisation rationnelle et on les incite à s'y insérer comme l'exige le simple bon sens. Aux clients qu'ils sont, l'écran ou la presse démontreront avec force anecdotes humaines tirées de la vie privée qu'ils disposent de la liberté de choisir, de céder au charme de la nouveauté. Dans tous les cas, ils resteront des objets.
Kulturindustrie est réédité cette année chez Allia dans la traduction d'Eliane Kaufholz.
Évidemment, quand les deux "pachycritiques" ("mastocritiques" ?) s'attaquent au divertissement, on ne s'attend pas à de la gaudriole ; n'empêche, ce passage m'a toujours secoué par ses accents irrésistiblement pascaliens (n°139, Brunschvicg) :
S'amuser signifie être d'accord. Ce n'est possible que si on isole l'amusement de l'ensemble du processus social, si on l'abêtit en sacrifiant au départ la prétention qu'a toute œuvre, même la plus insignifiante, de refléter le tout dans ses modestes limites. S'amuser signifie toujours : ne penser à rien, oublier la souffrance même là où elle est montrée. C'est effectivement une fuite mais, pas comme on le prétend, une fuite devant la triste réalité ; c'est au contraire une fuite devant la dernière volonté de résistance que cette réalité peut encore avoir laissé subsister en chacun. La libération promise par l'amusement est la libération du penser en tant que négation.